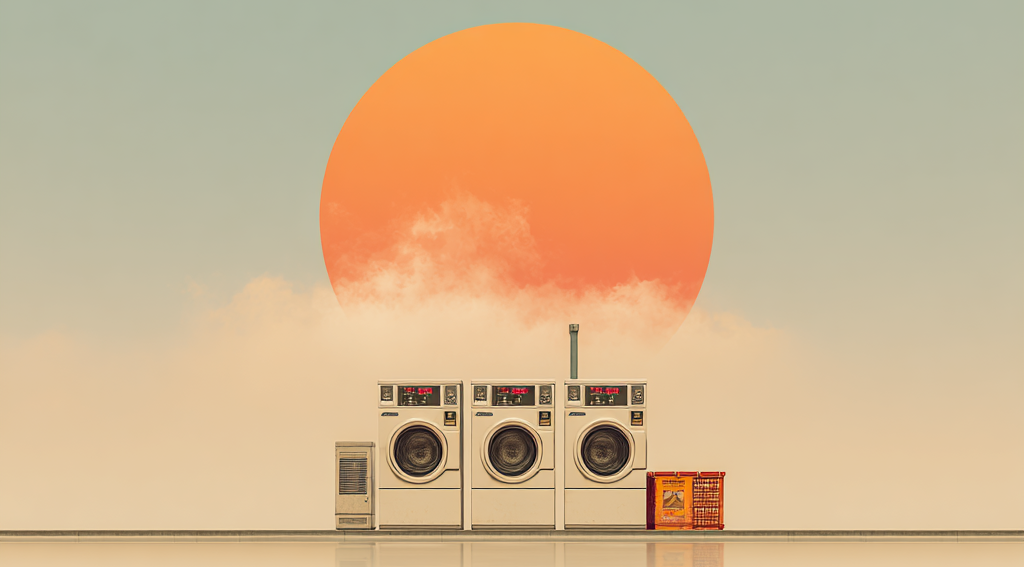
[Edito] « The Coin Laundry » : vers l’ère de la responsabilité des plateformes crypto?
Selon la récente enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), les services crypto permettent, chaque année, de transférer illégalement des milliards de dollars issus d’infractions. The Coin Laundry révèle comment certains réseaux exploitent les infrastructures crypto pour dissimuler ou déplacer des fonds illicites, relançant le débat sur le rôle des crypto-actifs dans les circuits criminels. Alors même que le secteur s’est construit sur un idéal de décentralisation et de transparence, il est aujourd’hui décrit par ce consortium de médias comme « un boulevard pour le blanchiment d’argent ».
Pourtant, ces révélations doivent être replacées dans un contexte plus large. La transparence des blockchains permet de tracer nettement plus facilement les flux financiers en crypto-actifs que ceux ayant cours dans les circuits bancaires traditionnels, qui demeurent les premiers vecteurs du blanchiment mondial. Toutefois, cette transparence ne signifie pas que ces actifs peuvent aisément être saisis, pour des raisons techniques (self-custody) et de collaboration de certains acteurs du secteur. Ainsi, la question centrale n’est pas tant de déterminer si la crypto est devenue un nouvel épicentre du blanchiment, mais plutôt de constater que certaines plateformes d’échange apparaissent régulièrement dans les schémas de blanchiment identifiés, ce qui pose inévitablement la question de l’engagement de leur responsabilité.
Un état des lieux réaliste du blanchiment crypto
L’enquête The Coin Laundry, orchestrée par l’ICIJ et 37 médias partenaires à travers 35 pays, a tracé des milliers d’adresses de wallets liées à des activités illicites et analysé des dizaines de milliers de transactions publiques sur blockchain. Elle révèle que certaines plateformes d’échange de crypto-actifs ont servi à faire transiter des sommes importantes émanant de fraudes ou du trafic de drogue.
L’enquête cite notamment l’institution financière cambodgienne Huione Group qui aurait transféré entre juillet 2024 et juillet 2025 plus de 408 millions de dollars vers des comptes clients ouverts auprès d’une plateforme régulée. Cet exemple illustre bien la manière dont certains réseaux criminels exploitent les crypto-actifs pour déplacer des fonds illicites, en profitant notamment de services ou d’intermédiaires dont les contrôles demeurent insuffisants. Pour autant, l’enquête documente des cas avérés et des flux précis, sans prétendre que la crypto constitue, à elle seule, le canal principal du blanchiment des activités criminelles internationales.
Un constat à relativiser : la crypto n’est pas le cœur du blanchiment mondial
Si The Coin Laundry met en évidence des flux illicites transitant par les crypto-actifs, ces pratiques doivent être replacées dans une perspective globale. En effet, les blockchains ne constituent qu’un vecteur parmi d’autres dans les schémas criminels de blanchiment, et les circuits bancaires traditionnels demeurent, de très loin, les principaux canaux utilisés, notamment en raison du recours à des montages complexes, bien plus difficiles à tracer que les transactions inscrites sur une blockchain.
Les données publiées par Chainalysis confirment cette réalité : en 2024, 40,9 milliards de dollars auraient été reçus par des adresses illicites identifiées, et la part des transactions associées à des activités illicites représenterait seulement 0,14 % de l’ensemble du volume on-chain, un niveau historiquement toujours inférieur à 1 %. Rapportée au volume total des transactions crypto, la part liée au blanchiment reste donc extrêmement faible. Ce décalage rappelle que la crypto occupe une place marginale dans l’économie du blanchiment : elle peut servir au blanchiment, mais elle n’en constitue ni l’outil principal ni l’axe central.
Le véritable défi : la responsabilité des intermédiaires
Si la crypto ne constitue pas aujourd’hui le cœur du blanchiment mondial, l’enquête The Coin Laundry met toutefois en évidence un point qui reste structurant pour le secteur : le rôle central de certaines plateformes d’échange dans les flux illicites identifiés. Certains schémas décrits par l’ICIJ ne reposent pas sur des infrastructures souterraines, décentralisées ou des services anonymes mais sur des acteurs établis, parfois enregistrés ou régulés. Autrement dit, une partie non négligeable du blanchiment identifié passe par des plateformes dont l’activité est déclarée, visible et, pour certaines d’entre elles encadrées et régulées.
Ce constat renvoie à un enjeu bien connu dans le secteur financier traditionnel : la responsabilité des intermédiaires. Depuis des années, les banques et les prestataires de services de paiement sont soumis à des obligations réglementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, se traduisant par des obligations de vigilance, de détection et de déclaration des opérations suspectes, susceptibles d’engager leur responsabilité pénale et civile. À l’inverse, malgré la régulation rapide du secteur (MiCA, TFR), les plateformes crypto bénéficient en pratique d’un régime de responsabilité encore relativement clément par rapport aux acteurs intermédiaires traditionnels (banque et PSP).
Dès lors, une question s’impose : pourquoi ces plateformes, qui assurent des fonctions analogues à celles des banques, n’assumeraient-elles pas des obligations comparables ? À mesure que les enquêtes on-chain mettent en lumière leur rôle déterminant dans certains schémas de blanchiment, la perspective d’un alignement progressif de leur régime de responsabilité devient difficile à contourner.


