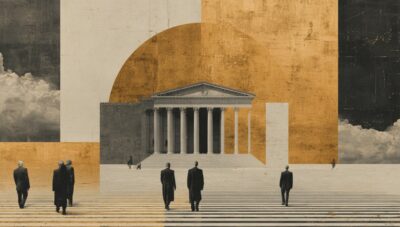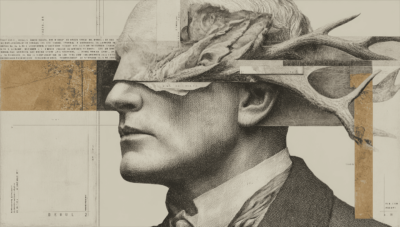[edito] Stablecoin : l’Europe se tire une balle dans le pied ?
Les stablecoins adossés à l’euro ne pèsent qu’environ 1 % de la capitalisation mondiale ; un chiffre qui dit tout de la marginalisation de la monnaie européenne dans la nouvelle économie numérique.
Les raisons de cette marginalisation sont diverses. Mais la réglementation européenne a-t-elle pu jouer un rôle pour limiter au lieu de développer les stablecoins euro ?
Cette interrogation résonne avec l’actualité. Philippe Aghion, tout juste récompensé par le Prix Nobel 2025 pour ses travaux sur le lien entre innovation et croissance, rappelle combien la régulation peut être un levier ou un frein.
Sur ce point, le cas des stablecoins euros est un cas pratique passionnant. Ainsi, le règlement MiCA contient quatres exigences qui nuisent à l’émergence des stablecoins euros.
Les trois verrous de MiCA
L’entrée en vigueur de MiCA en juin 2024 devait marquer un tournant pour l’émergence d’un marché crypto régulé en Europe. Mais cette réglementation, en ce qui concerne les stablecoins, consacre surtout la méfiance des institutions envers l’initiative privée. Sous couvert de protection et de souveraineté économique (qui n’est possible qu’avec un secteur privé puissant…), le législateur a multiplié les freins qui condamnent les acteurs européens à la marginalité.
Premier verrou : MiCA impose de déposer entre 30 % et 60 % des réserves auprès d’établissements de crédit européens, des seuils supérieurs à ceux de la monnaie électronique. Résultat : une moindre rémunération des fonds et un modèle économique fragilisé, là où les émetteurs américains disposent d’une flexibilité bien plus large.
Second verrou : L’EBA elle-même l’a reconnu dans sa non-action letter du 12 juin 2025 : le risque de double agrément MiCA/PSD2 contrevient au principe de proportionnalité. Pourtant, aucune clarification n’a suivi. Les prestataires demeurent pris au piège d’une double conformité pour un seul instrument.
Troisième verrou : le statut d’« émetteur significatif », conçu pour encadrer les acteurs les plus importants, introduit une supervision directe de l’EBA. En plus d’ajouter un niveau de supervision, ce statut repose sur des seuils sont tout sauf simples. En clair : mieux vaut rester petit pour éviter une nouvelle couche de réglementation et de complexité.
À noter que l’interdiction faite à l’émetteur de stablecoins de verser des intérêts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ne constitue pas un véritable verrou, dans la mesure où un instrument de paiement monétaire n’a pas vocation à être un produit de rendement. À défaut, il risquerait de sortir du cadre juridique applicable à la monnaie électronique.
Ces contraintes ne suffisent pas à expliquer à elles seules la rareté des stablecoins euro, mais elles en constituent l’arrière-plan réglementaire : une Europe prudente jusqu’à la paralysie, où la souveraineté sert de prétexte à un excès de contrôle institutionnel.
L’euro numérique, au risque du Minitel ?
Ce verrouillage réglementaire révèle une fracture politique plus profonde entre les deux rives de l’Atlantique.
Aux États-Unis, la domination du dollar est assumée comme un instrument de puissance, y compris au moyen des stablecoins. Le Congrès avance vers un cadre législatif pragmatique et favorable au marché. Les régulateurs américains partent d’un postulat simple : la confiance dans l’initiative privée est la condition de l’émergence d’un marché fort, lui-même source de souveraineté économique.
En Europe, la logique est inversée. Le projet d’euro numérique porté par la BCE monopolise l’attention et les ressources, au détriment des initiatives privées. Présenté comme un bien public numérique, il est conçu pour « protéger l’euro » des stablecoins… quitte à en dissuader l’émergence.
Comme l’a rappelé Christine Lagarde (BCE) : “Beyond addressing some of the risks posed by stablecoins, a digital euro would help safeguard Europe’s bank-based financial and monetary system. Not only would it strengthen Europe’s strategic autonomy, but it would also ensure an innovative and resilient European retail payments system.”
Le paradoxe est cruel : la sacro-sainte stabilité financière justifie des règles nuisibles à la croissance, et à notre souveraineté monétaire (dans le web3). Or, comme l’enseignent les travaux d’Aghion, la croissance durable naît de l’équilibre entre règles claires et liberté d’innover. Si nous voulons que l’euro demeure une monnaie d’avenir, rappelons-nous qu’aucune souveraineté ne se décrète. Elle se construit, et ce sont les acteurs privés qui, in fine, en seront les bâtisseurs.